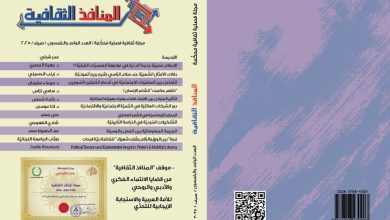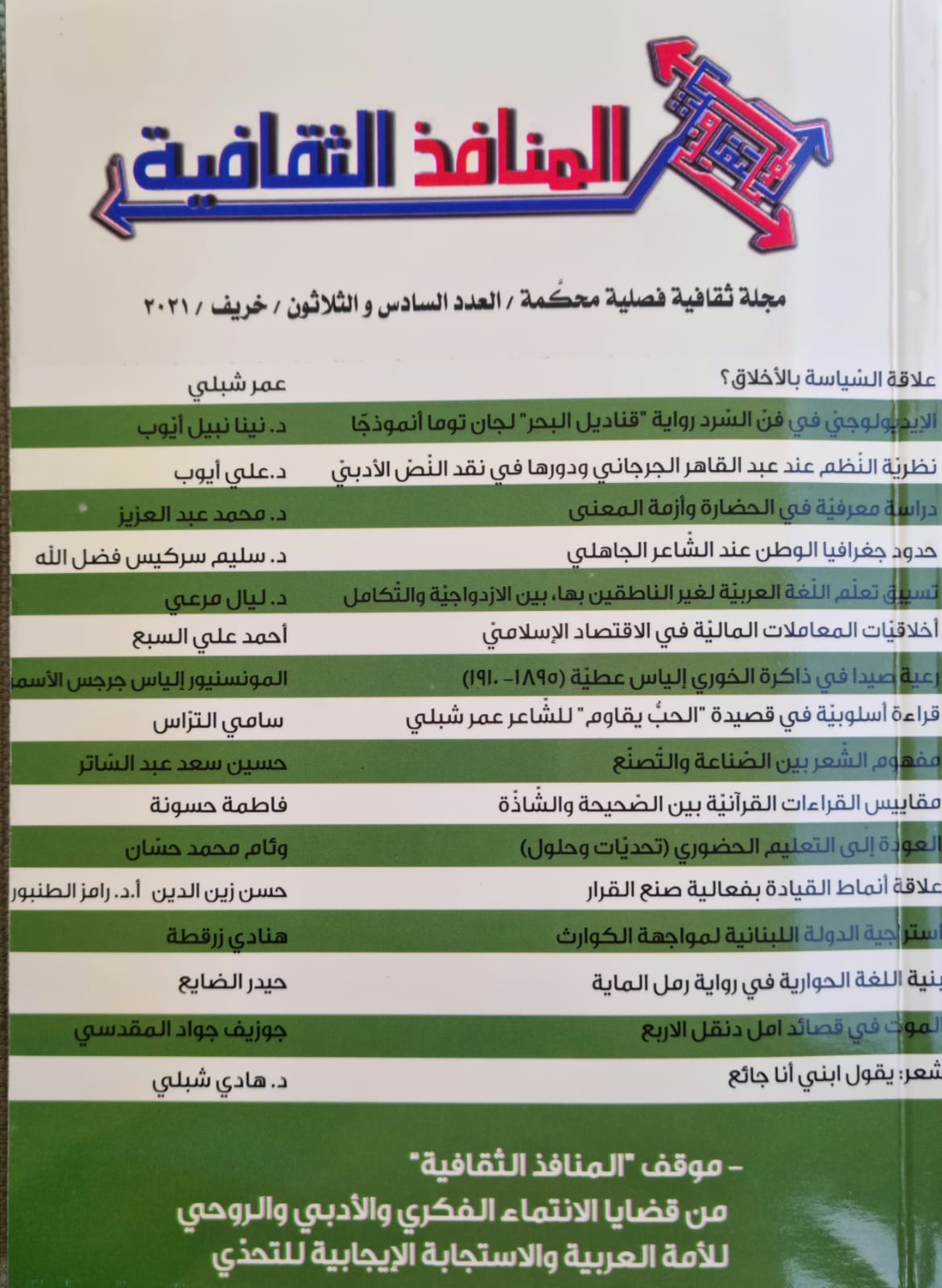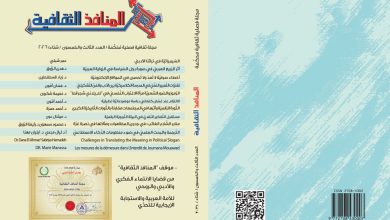Les effets des crises sur les entreprises libanaises
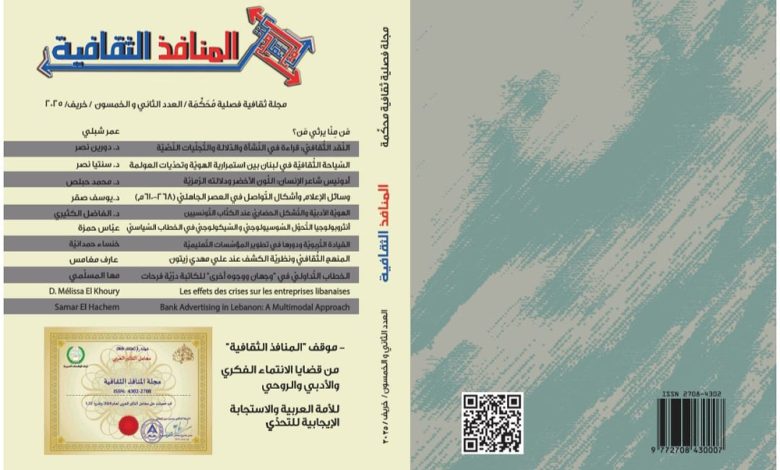
Les effets des crises sur les entreprises libanaises
واقع الشّركات اللّبنانيّة في ظلّ الأزمات المتتالية
Mélissa El Khoury
مليسا غازي الخوري
Sous la direction du Prof. Audine Salloum
تاريخ الاستلام 1/ 6/ 2025 تاريخ القبول 14/ 7/2025
Résumé
Les entreprises libanaises ont traversé une période de crise continue sans précédent. La pandémie, connue sous la COVID-19, a imposé la fermeture prolongée des sociétés, réduisant la consommation, tandis que le manque d’infrastructures numériques a freiné leur adaptation et leur improvisation dans le but de maintenir l’activité commerciale. L’explosion du port de Beyrouth en août 2020 a détruit des infrastructures essentielles, a entraîné des pertes économiques massives et a accéléré l’exode de talents qualifiés vers l’étranger. La dévaluation continue de la livre libanaise a aggravé la situation, augmentant les coûts d’importation et réduisant le pouvoir d’achat des consommateurs. À cela s’ajoute l’impact régional de la guerre du 7 octobre 2024, qui a perturbé les importations et accentué l’instabilité politique, décourageant les investisseurs étrangers. Ces crises ont conduit à une contraction significative dans des secteurs clés comme le tourisme, l’industrie et le commerce, contraignant de nombreuses petites et moyennes entreprises à cesser leurs activités. En d’autres termes, ces crises qui se suivent ont conduit à l’effondrement économique du pays conduisant à son tour à l’application des termes de la faillite à certaines entreprises.
Mots clés :
Crise, entreprises libanaise, faillite, impécuniosité
الملخص
تحمّلت الشّركات اللّبنانيّة مرحلة غير مسبوقة من الأزمات المتواصلة. فقد فرضت جائحة كوفيد-19 إغلاقات طويلة الأمد، ما أدّى إلى تراجع الاستهلاك، في حين أعاق غياب البنية التّحتيّة الرّقميّة قدرة الشّركات على التّكيّف والاستمرار في العمل. كما أدّى انفجار مرفأ بيروت في آب 2020 إلى تدمير البنى التّحتيّة الحيويّة، وتكبيد الاقتصاد خسائر جسيمة، وتسريع وتيرة هجرة الكفاءات إلى الخارج. وزادت الأزمة تعقيدًا مع استمرار تدهور قيمة اللّيرة اللّبنانيّة، ما أدى إلى ارتفاع كلفة الاستيراد وتراجع القدرة الشّرائيّة للمواطنين.
وتفاقمت هذه التّحديات مع التّداعيات الإقليميّة لحرب 7 تشرين الأول 2024 التي تسبّبت في تعطيل سلاسل التّوريد وزيادة حالة عدم الاستقرار السّياسيّ، ما نفّر المستثمرين الأجانب. وقد أدّت هذه الأزمات المتلاحقة إلى انكماش كبير في قطاعات أساسية مثل السّياحة والصّناعة والتّجارة، وأجبرت العديد من المؤسّسات الصّغيرة والمتوسطة على الإغلاق. وباختصار، دفعت هذه الأزمات المتتالية البلاد إلى حافة الانهيار الاقتصاديّ، وأُجبرت العديد من الشّركات على الدخول في إجراءات الإفلاس.
الكلمات المفتاحيّة: أزمة، الشّركات اللّبنانيّة، إفلاس، عجز ماليّ.
Introduction
1.Les entreprises libanaises luttent pour se reconstruire après la COVID, l’explosion du 4 août à Beyrouth, l’inflation du dollar américain et la guerre du 7 octobre 2024.
2.La pandémie, soit la COVID-19, a marqué le début d’une période de bouleversements économiques sans précédent, durant laquelle les entreprises libanaises ont dû faire face à des fermetures prolongées. Les confinements successifs ont entraîné une interruption des activités commerciales. Et avec la réduction de la consommation et l’absence de touristes internationaux, de nombreuses société ont enregistré des pertes significatives, alors que celles basées au niveau d’autres pays ont rapidement adopté des modèles numériques qui n’étaient pas présents au Liban. De nombreuses entreprises libanaises n’avaient ni l’infrastructure ni les ressources nécessaires pour se moderniser comme tel.
3.L’explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020 a aggravé les difficultés financières et économiques des entreprises localisées sur le territoire libanais et ceci par la destruction des infrastructures qui étaient proches du port, qui abritaient des dizaines d’entreprises, par les dommages directs qui ont été estimés à plusieurs milliards de dollars, et qui ont affecté directement les sociétés commerciales et les chaînes d’approvisionnement et enfin, par le fait que l’explosion a accéléré l’émigration de nombreux professionnels qualifiés, privant les entreprises locales de talents essentiels.
4.La crise monétaire, exacerbée par la dévaluation continue de la livre libanaise vis-à-vis du dollar américain, a créé une hausse des coûts d’importation, les entreprises dépendantes des biens importés ont vu leurs charges augmenter de manière significative. De plus, il y a eu une réduction du pouvoir d’achat, les consommateurs, touchés par cette crise, ont sévèrement réduit leurs dépenses et enfin, l’accès aux crédits bancaires en devise libanaise ou étrangère est devenu presque impossible pour la plupart des entreprises commerciales et même pour les profanes.
5.Suite à toutes ces crises, à impact financier, susmentionnées, un dernier événement devrait être mentionné et celui-ci est la guerre du 7 octobre 2024. Bien que la guerre ne se déroulait pas initialement et directement sur le territoire libanais, ses conséquences régionales affectent le pays. Le Liban, fortement dépendant des importations, souffre des perturbations régionales dues au conflit. L’instabilité politique est mise en relief et cette guerre a augmenté les tensions internes rendant toute réforme économique encore plus difficile mettant en place une atmosphère d’instabilité géopolitique décourageant, ainsi, les investisseurs internationaux et limitant les capitaux disponibles pour la relance financière.
6.Suite l’élévation rapide, ces évènements ont eu de profondes implications économiques, notamment une contraction significative dans des secteurs principaux tels que le tourisme, l’agriculture, l’industrie manufacturière, le commerce et d’autres services. Le dérèglement des activités commerciales et des chaînes d’approvisionnement, les bombardements directs et la baisse de la demande des consommateurs ont contraint une grande partie des entreprises, en particulier les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises, à mettre fin à leurs activités commerciales ou à les suspendre. Le PNUD (Programme des Nations unies pour le développement) estime que la hausse du taux de chômage affectera environ 1,2 millions de travailleurs dans le pays atteignant ainsi un chiffre alarmant de 32,6 % d’ici la fin de l’année[1]. Alors, quels seront les effets de l’impact des crises sur les entreprises libanaises? En premier lieu, il faudra s’attarder sur la notion d’effondrement économique de ces entreprises (TITRE I) et en second lieu, il faudra étayer l’idée de la gestion des faillites dans le cadre libanais (TITRE II).
Titre 1er : la notion d’effondrement économique des entreprises libanaises
7.Les effets des crises susmentionnées sont significatifs. En cinq ans, la livre libanaise a perdu plus de 98 % de sa valeur vis-à-vis du dollar américain, aboutissant, ainsi, à une inflation importante qui a rendu les produits de base hors de prix pour une part des citoyens. Afin de tenter d’enrayer le phénomène et d’en dissuader profiteurs de cette situation, le ministre de l’Économie libanais a lancé une application mobile pour dénoncer des hausses de prix trop importantes mais tous ces efforts n’ont abouti. Dans un pays coincé, la Banque mondiale estime le taux de pauvreté absolue, soit une part de la population soit 50% vit avec moins de 1,90 dollar par jour. En 2023, le taux de chômage a atteint 30%. Sans emploi et sans perspective de viabilité, les nouvelles générations choisissent l’exode et ont arrêté d’y croire[2]. L’effondrement économique n’a pas eu, uniquement, un impact direct sur les profanes. En effet, les entreprises localisées sur le territoire libanais ont eu leur part de ces crises.
8.Selon le cabinet de statistiques Information International, le Liban a vu partir 175.500 de ses citoyens en 2023, près de 200 % de plus que l’année précédente. Cette fuite des cerveaux ternit encore un peu plus l’avenir de ce pays[3]. Sans main-d’œuvre pour reconstruire une économie enfoncée et menacée par une guerre totale, le futur du pays s’annonce de plus en plus sombre. De ce fait il serait intéressant de discuter du contexte économique des entreprises libanaises (A) pour qu’ensuite donner des exemples de secteurs commerciaux vivement touchés (B).
A-Le contexte économique des entreprises libanaises
9.Le Liban se trouve dans une situation de blocage institutionnel et d’impasse économique aggravés par un environnement régional marqué par une forte instabilité politique. Les perspectives de stabilisation financière à court et moyen terme demeurent très incertaines, en grande partie conditionnées par l’évolution du conflit au Sud du pays. Les réformes économiques et les négociations avec le FMI (Fond Monétaire International) restent paralysées, et les indicateurs macroéconomiques affichent une dégradation en permanence. Le PIB (Produit Intérieur Brut), qui a été réduit de 60 % par rapport à 2018, s’est stabilisé en 2022 autour de 20 milliards de dollars. Bien que l’inflation a été ralentie, elle reste présente et significative, atteignant environ 70% au début de l’année 2024. Certains signaux, tels que le niveau des importations et l’indice PMI (Purchasing Manager’s Index-indice des directeurs des achats), laissent observer une reprise partielle de l’économie réelle, désormais largement soutenue par la diaspora libanaise par le transfert de fonds et les retours des saisonniers par exemple et l’expansion de l’économie informelle[4].
- Le secteur bancaire libanais reste largement dysfonctionnel, affrontant des défis majeurs de solvabilité et de liquidité, exacerbés par des pertes estimées à 75 milliards de dollars. Le déséquilibre des bilans commerciaux est préoccupant, ils affichent un passif de 90 milliards de dollars de dépôts clients, contre un actif de 84 milliards de dollars de dépôts auprès de la Banque centrale, en grande partie disparus comme par magie. La dévaluation de la livre libanaise a anéanti la valeur des fonds propres aux banques, compromettant leurs stabilités juridique et financière. Jusqu’en 2023, le secteur bancaire parvenait à générer des profits principalement grâce aux opérations de change sur la plateforme صيرفة et à l’investissement de liquidités offshore à des taux élevés. Cependant, l’arrêt de la plateforme en question a fragilisé davantage le modèle économique dessiné, en l’absence d’octroi de crédits, et des indications suggèrent que certains dépôts en dollars pourraient être utilisés pour financer les dépenses courantes de certaines institutions bancaires, soulevant des enjeux de conformité et de transparence. En parallèle, une montée en puissance rapide d’un secteur financier non bancaire commence à voir le jour, faiblement ou non régulé, qui constitue un défi pour la supervision juridique et accroit les risques de non-conformité, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Par ailleurs, la dollarisation croissante de l’économie et l’expansion d’un secteur informel opérant en espèces accentuent les risques juridiques et économiques. Le recours accru à une économie en espèce, qui est passé de 4,5 milliards de dollars en 2020 à 9,9 milliards de dollars en 2022, représentant désormais 46 % du PIB, a des répercussions juridiques significatives. Cette tendance réduit l’efficacité de la collecte fiscale, compliquant le contrôle fiscal et augmentant les risques de criminalité financière, tels que le blanchiment d’argent et le financement illicite. Pour remédier à cette situation, une réforme législative et réglementaire du secteur financier est impérative, afin de restaurer la confiance, renforcer les mécanismes de conformité et limiter l’économie parallèle. L’absurdité de la situation et son imposition soudaine n’a pas préparé les mentalités commerciales, les mettant, ainsi, dans une situation de déni malgré que tous les indices pendant des décennies dévoilaient les répercutions que le pays traverse en ce moment.
B.Les secteurs commerciaux touchés par les crises
11.Les crises successives au Liban ont profondément impacté les secteurs commerciaux, mettant en danger leur fonctionnement et leur continuation. Le secteur bancaire, autrefois pilier de l’économie, a été gravement affaibli par des pertes massives, des restrictions sur les dépôts et l’incapacité à octroyer des crédits, privant ainsi les entreprises de liquidités essentielles.
12.Le commerce de détail a également été fortement touché. La baisse du pouvoir d’achat a réduit la demande intérieure, fragilisant particulièrement les petits commerces. La hausse des prix des biens importés et la concurrence accrue de l’économie informelle ont exacerbé leurs difficultés.
13.Le secteur touristique, déjà affecté par les tensions politiques, a subi un déclin marqué avec la pandémie de COVID-19 et l’instabilité sécuritaire. Les hôtels et restaurants fonctionnent au ralenti, dépendant principalement des expatriés libanais en visite saisonnière.
14.L’immobilier et la construction, autrefois moteurs de croissance, ont été paralysés par le manque de financements, la baisse des investissements et le manque accru de liquidité. Les projets en cours ont été suspendus et la valeur des biens immobiliers a considérablement baissé.
15.Le secteur médical fait face à des pénuries critiques de médicaments et de fournitures, aggravées par les difficultés d’importation et de marchés noirs. Les hôpitaux et les pharmacies peinent à répondre à la demande croissante tout en subissant une hausse des coûts.
16.L’industrie manufacturière a également souffert de la flambée des coûts des matières premières, des coupures d’électricité et de l’instabilité monétaire, limitant sa production et sa compétitivité.
17.Les pénuries de carburant ont lourdement impacté les secteurs de l’énergie et des transports, augmentant les coûts logistiques et provoquant des interruptions dans les chaînes d’approvisionnement sans oubliés la hausse des prix facturée à toute sorte d’entreprises.
18.Le secteur technologique, bien que plus résilient, a été freiné par les coupures d’électricité et l’exode des talents qualifiés, limitant ainsi son développement et son évolution.
19.Autrement dit, ces crises ont conduit à des fermetures massives d’entreprises, une montée du chômage et à une perte de confiance des investisseurs. La relance de ces secteurs dépendra de réformes structurelles et législative, d’un accès accru au financement et à un environnement juridique stable pour favoriser la reprise économique.
20.S’intéressant spécifiquement aux entreprises à portée et visée commerciales, les chiffres de défaillance de celle-ci sont globalement dans la moyenne de ce qui peut s’observer au sein des autres domaines d’activité. Avec une hausse mesurée par nombre de secteurs, montrant ainsi la résilience des commerçants, dont l’activité a pourtant été particulièrement perturbée par l’inflation en 2023. Les magasins multi-rayons (épiceries, superettes, supermarchés) enregistrent ainsi une hausse limitée tout comme le commerce de détail alimentaire (boulangeries-pâtisseries, boucheries, charcuteries…)[5].
21.Au Liban et partout dans les alentours, les crises qui sont survenues l’une à la suite de l’autre ont impacté considérablement le secteur commercial et financier qui a tout de même essayer de se relever mais parfois en vain.
Titre 2nd : La gestion de la faillite au Liban
22.La gestion de la faillite au Liban est confrontée à de nombreux défis, reflétant les failles structurelles du cadre juridique et économique du pays. Le système actuel repose sur des lois obsolètes, largement inspirées du droit français du début du XXᵉ siècle, qui ne répondent plus aux besoins des entreprises modernes et développées. Ces lois manquent de mécanismes efficaces pour permettre la restructuration des entreprises en difficulté, les contraignant souvent à opter directement pour une liquidation désordonnée. Notant que le droit de la faillite libanais en cours en ce moment date de 1942.
23.Les tribunaux commerciaux, chargés de superviser ces procédures, souffrent d’un manque de spécialisation et de ressources légales et financières, ce qui entraîne des retards et un manque de transparence. Par ailleurs, l’absence de hiérarchisation claire des créances complique la protection des droits des créanciers, notamment les banques, dont la récupération des fonds n’est pas garantie. Cette situation accentue les fermetures brutales et soudaines des sociétés commerciales, entraînant, ainsi, des pertes d’emplois massives et une baisse de la confiance des investisseurs.
24.En l’absence d’un cadre adapté, de nombreuses entreprises formelles disparaissent, alimentant la croissance de l’économie informelle. Ce secteur, non régulé et échappant aux obligations fiscales, aggrave les distorsions économiques et les difficultés de collecte de recettes publiques.
25.Pour remédier à cette situation, il est crucial de moderniser le cadre juridique en introduisant des lois inspirées des meilleures pratiques internationales. Celles-ci devraient inclure des procédures de redressement, de restructuration et de liquidation ordonnées. Par conséquence, il est essentiel de renforcer les tribunaux commerciaux en formant des juges spécialisés en la matière et en améliorant leur efficacité technique. La mise en place de mécanismes alternatifs de résolution des litiges, tel que l’arbitrage, pourrait également faciliter les négociations entre entreprises et créanciers mais ceci demande également un travail législatif acharné.
26.Une hiérarchisation claire des créances, garantissant une répartition équitable des actifs en cas de liquidation des biens, est nécessaire afin de protéger les droits des créanciers. Enfin, il est indispensable de créer des fonds de soutien pour accompagner les entreprises viables mais temporairement en difficulté, tout en luttant contre l’économie informelle par des incitations fiscales et réglementaires. De ce fait, il sera important d’étudier spécifiquement la notion de faillite (A) pour qu’ensuite pouvoir s’attarder sur la notion d’impécuniosité à l’égard de celle de la faillite (B).
A.La notion de faillite en droit libanais
27.Le système de la faillite a été défini depuis le Moyen Âge, avec des débuts dans les villes commerciales du nord de l’Italie. Ses règles revêtaient alors un caractère punitif et répressif. On parlait de « banca rotta » ou de « banqueroute », terme provenant de l’idée que « le banc du vendeur est brisé ». Ensuite, le terme a élargi son sens pour inclure l’idée de faillite, mais il désignait également les actes criminels commis par le commerçant failli, qui étaient punis selon leur gravité, soit par des peines légères si la faillite était mineure, soit par des peines criminelles si elle était frauduleuse[6].
28.Quant au mot « faillite » en arabe, il dérive du mot “فلوس“, qui désigne l’état d’un homme n’ayant plus d’argent, c’est-à-dire passant de la prospérité à la détresse. Il en découle que l’idée de faillite est étroitement liée à celle des biens, et plus précisément à celle de la responsabilité financière des individus. Les biens sont le pivot principal de la plupart des systèmes juridiques, et le législateur, à chaque étape, s’efforce de garantir l’intérêt financier des individus, que ce soit par le droit pénal ou même à travers les règles du droit commercial. Conscient des besoins observés pour dynamiser l’activité des commerçants, le législateur a consacré les principes de confiance et de rapidité dans les transactions commerciales, cherchant à assurer l’efficacité de ces deux principes dans chaque disposition du code de commerce, en établissant un système de faillite visant à créer un cadre légal pour les obligations du failli. La faillite libanaise est donc une stigmatisation qui frappe le débiteur, ternissant son dossier commercial et altérant ainsi les contours de sa vie professionnelle. Le législateur a, par le biais des textes légaux, cherché à rendre le système de faillite plus fonctionnel, afin d’éviter que le commerçant n’y ait recours par tous les moyens possibles, compte tenu des conséquences néfastes qu’elle entraîne tant pour le débiteur que pour les créanciers.
29.De plus, la faillite se distingue des actions juridiques, comme l’action directe, l’action indirecte ou l’action paulienne, consacrées dans le droit civil, car ces dernières nécessitent de nombreuses conditions dont les effets ne se répercutent que sur la personne qui les a engagées. Le créancier qui initie une action bénéficie seul de ses résultats. Ainsi, le créancier qui intente sa demande en premier en tire profit, récupérant l’intégralité de sa créance avant les autres créanciers[7], laissant aux autres créanciers la seule option d’intenter une nouvelle action pour recouvrer la valeur de leur créance à partir des actifs restants du débiteur. Par conséquence, le législateur a estimé que cette situation ne s’accordait pas avec la nature des transactions commerciales, et il était donc nécessaire de mettre en place des règles spécifiques et un système particulier pour les commerçants et les transactions commerciales, en adéquation avec la rapidité et la confiance qui caractérisent les relations commerciales. Ainsi, un système de faillite actuel, utilisé a été établi. La faillite est donc un moyen d’exécution collective visant à maintenir l’égalité entre tous les créanciers, permettant de vendre les biens du commerçant en cessation de paiement et de distribuer le produit de cette liquidation entre les créanciers sans aucune préférence, sauf si l’un d’eux bénéficie d’un privilège ou d’un gage[8].
30.Ainsi, le commerçant, débiteur, se trouvant dans une situation désespérée, est soumis à une action collective visant à préserver l’égalité des droits des créanciers[9]. Ainsi, en droit libanais, la faillite n’est qu’une procédure d’exécution visant à organiser les obligations du failli par rapport à ses actifs, où les éléments d’actifs et de passifs sont déterminés puis liquidés afin d’essayer de restituer au mieux les créances dues à échéance. Le droit civil, quant à lui, ne comporte pas de système de liquidation collective des biens du débiteur qui a manqué à ses obligations de paiement, et par conséquent reconnaît le principe de la poursuite individuelle, où chaque créancier a le droit de se retourner contre son débiteur et de saisir ses biens, bien qu’il permette aux autres créanciers, en cas de présence, de participer à l’exécution.
B.La relation entre l’impécuniosité et la faillite
31.La notion d’impécuniosité est relative au manque ou à l’absence de liquidités ou de ressources financières, Autrement dit, le manque d’actif. Un failli est considéré comme impécunieux lorsqu’il ne dispose pas de moyens financiers nécessaires afin de subvenir à ses besoins qui se traduisent par la restitution des dettes des créanciers intéressés. Cette impécuniosité peut résulter de différents facteurs, tels que des difficultés économiques, des pertes financières, des dettes importantes, un manque d’actif ou de revenus insuffisants pour couvrir les dépenses courantes et les dettes dues. Elle peut toucher aussi bien les débiteur, personne physique ou morale. Par conséquent, quand le débiteur est considéré impécunieux, ceci ne s’arrête pas au niveau de cette description, comme ça a était mentionné ci-dessus. En réalité, diverses implications juridiques significatives, notamment dans le cadre de la faillite en droit libanais peuvent survenir entrainant, ainsi, la création d’un facteur déterminant pour les décisions qui seront prises concernant la gestion des actifs, le remboursement des dettes, ou l’octroi de mesures de protection ou d’aide financière. L’impécuniosité du débiteur serait, donc, un facteur indispensable et qui devrait être pris en compte dans le cadre d’une faillite car il met en relief les décisions concernant l’ouverture de la procédure, la gestion des actifs et l’élaboration de celle-ci, tout respectant, tant que possible, les intérêts des créanciers et des parties prenantes impliquées. Autrement dit, le pouvoir financier du débiteur permettra de guider les intéressés et le juge compétent dans leurs observations tout en permettant à ce dernier de mettre en place la bonne démarche à suivre en notant que l’impécuniosité irréversible aura de forts impactes
32.En ce qui concerne le droit libanais, la cessation de paiement est l’arrêt de paiement des dettes commerciales venues à échéance. Il n’est pas nécessaire que le commerçant cesse de payer toutes ses dettes commerciales dues, mais il suffit qu’il en arrête le paiement d’une seule, quelle qu’en soit son importance ou sa priorité. La créance non payée doit toutefois être de nature commerciale ou relative à des besoins commerciaux, et non civile, comme celles en rapport avec les besoins personnels, familiaux ou domestiques du commerçant afin que le sujet de faillite soit entamé. Une personne physique ou morale ne peut être déclarée en faillite, même s’elle est insolvable, tant qu’elle s’acquitte de ses dettes commerciales à leur échéance, à condition que les moyens de paiement utilisés soient licites. Le commerçant est également considéré comme en cessation de paiements s’il ne maintient pas la confiance financière en lui, sauf à l’aide de moyens manifestement illicites[10]. La dette dont le paiement est interrompu doit être commerciale à la date de la cessation de paiements. Il appartient au juge pénal d’évaluer si le commerçant est en état de cessation de paiements de ses dettes commerciales.
33.La décision du tribunal commercial concernant la cessation de paiement et la déclaration de faillite ne lie pas le juge pénal, qui peut reconnaître le commerçant coupable de faillite, même si le tribunal commercial a conclu à l’absence des conditions de la faillite. Si, au cours d’un procès civil, commercial ou pénal, il apparaît que le commerçant est manifestement en état de faillite, le tribunal peut appliquer les dispositions de la faillite, même si celle-ci n’a pas été officiellement déclarée, conformément à l’article 498 du Code de commerce libanais[11]. La cessation de paiement des dettes commerciales peut être prouvée par tous moyens de preuve et laissés à l’appréciation du juge saisi du litige. Donc, en d’autres termes, en droit libanais, il faut que le débiteur soit en arrêt de paiement et pas besoin de prouver qu’il y a plusieurs défaillances de paiement il suffit qu’il n’ait restitué au moins une dette commerciale et qu’il soit en détresse financière afin qu’il soit nommé failli. Enfin, en droit libanais, au débiteur de déclarer son impuissance économique[12] et ceci relève de sa responsabilité et à défaut il sera suivi pénalement.
34.L’impécuniosité a été un facteur déterminant dans la faillite de nombreuses entreprises libanaises suite aux crises successives. Les restrictions bancaires ont privé ces sociétés de l’accès à leurs liquidités, indispensables pour couvrir leurs charges courantes telles que les salaires, les loyers ou le paiement des fournisseurs. En parallèle, la dévaluation massive de la livre libanaise a entraîné une hausse des coûts des matières premières et des produits importés, compliquant davantage la gestion financière des entreprises. La baisse du pouvoir d’achat de la population a réduit la demande intérieure, impactant directement les revenus des entreprises. De plus, la migration d’une partie importante de la population active et des investisseurs a encore aggravé cette chute de la consommation. Face à cette situation économique, de nombreuses entreprises ont dû s’endetter davantage, souvent à des taux d’intérêt significatif, ce qui a entrainé leur fragilité économique. L’impossibilité de rembourser leurs dettes à échéance a souvent conduit à des litiges juridiques ou à la faillite. L’absence de cadre juridique efficace pour la réorganisation des dettes ou la protection contre la faillite a accentué les difficultés. Les entreprises se sont retrouvées soumises à leurs créanciers sans possibilité de négocier des solutions viables. De plus, la montée de l’économie informelle, opérant en dehors des règles législatives fiscales et sociales, a créé une concurrence déloyale qui a fragilisé davantage les entreprises. En somme, le manque de liquidités, l’effondrement de la demande, l’endettement accru et l’absence de soutien juridique ont formé un cercle vicieux conduisant à la fermeture de nombreuses sociétés à visée commerciale. La mise en place de réformes juridiques et économiques est essentielle dans le but de restaurer la confiance, soutenir les entreprises et relancer l’économie libanaise.
Conclusion
35.Les crises que le Liban essaie de surmonter ne sont pas uniquement basées sur des faits économiques. En revanche, elles ont révélé la fragilité des entreprises locales face à ce contexte économique dévastateur. Dans le but de surmonter cette atmosphère une réforme juridique, en premier lieu, doit voir le jour. Celle-ci permettra, peut-être de donner une nouvelle chance au système financier libanais essayant, ainsi, de le redresser dans la mesure du possible.
36.Les entreprises locales, qui constituent le cœur de l’économie, se retrouvent particulièrement exposées et mises en relief dans ce contexte de crise. En effet, leurs fragilités s’expliquent par des problèmes tels que la dépendance excessive au système bancaire, le manque de diversification économique, et la faiblesse juridique. Cette vulnérabilité a été exacerbée par la dévaluation de la livre libanaise, l’hyperinflation et les restrictions bancaires, qui ont limité leurs capacités à opérer efficacement.
37.Afin de surmonter cette situation, ou au moins dans le but d’y essayer, une réforme juridique est impérative. Celle-ci doit inclure plusieurs démarches. En premier, il faut qu’il y ait un renforcement de la transparence et de la responsabilité et ceci en mettant en place des lois plus strictes pour lutter contre la corruption et favoriser la transparence dans les activités commerciales. En second, la protection des investisseurs et des entreprises devrait être une priorité en modernisant le cadre juridique dans l’objectif d’offrir un environnement plus favorable aux investissements, locaux et étrangers, et dans le but, aussi, de protéger les petites et moyennes entreprises (PME) contre les crises économiques et financières. En troisième, la restructuration du secteur financier devrait être mise en place et établissant une législation qui facilite la restructuration du secteur bancaire et l’amélioration de la confiance au sein de ce système. Cela inclura la garantie des dépôts et des mécanismes clairs pour gérer les défaillances bancaires. Enfin et le plus important, serait la mise en place sérieuse de l’ancien de droit de la faillite datant de 1942. Ce droit n’est plus d’actualité et ne répond plus au demande du marché. Il faudra le restructurer et l’élaborer afin de construire un cadre juridique qui permettra aux entreprises en difficulté de se réorganiser ou de liquider leurs actifs de façon équitable.
38.Avec l’adoption d’une telle réforme juridique, le Liban pourrait commencer à stabiliser son système financier et à redonner confiance aux investisseurs et aux acteurs économiques. Cette étape cruciale, bien qu’insuffisante à elle seule, constituerait un point de départ essentiel pour la reconstruction et la résilience du pays face à ses multiples défis.
Bibliographie
Ouvrage:
- LECUYER, « La faillite de l’entreprise en droits libanais et français », CEDROMA, 2004, p. 165.
Webographie
-SWEID M., UNDP, « Escalade des hostilités au Liban : le Programme des Nations Unies pour le développement met en garde contre une crise socio-économique », < https://www.undp.org/lebanon/press-releases/escalade-des-hostilites-au-liban-le-programme-des-nations-unies-pour-le-developpement-met-en-garde-contre-une-crise-socio>, 24 octobre 2024.
-THOMAS P-L., Le particulier Figaro, « L’économie libanaise s’enfonce un peu plus dans le chaos », < https://www.lefigaro.fr/conjoncture/l-economie-libanaise-s-enfonce-un-peu-plus-dans-le-chaos-20240928#:~:text=Dans%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9%2C%20les%20effets,une%20partie%20de%20la%20population>, 28 septembre 2024.
-Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, « Direction générale du trésor », <https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/LB/cadrage-general#:~:text=Entre%202019%20et%202023%2C%20les,par%20les%20d%C3%A9penses%20de%20fonctionnement>, 27 juin 2024.
-MAUREL L., « Commerces en faillites : quels sont les secteurs les plus impactés ? », < https://lechommerces.fr/faillites-dentreprises-quels-sont-les-secteurs-du-commerce-les-plus-impactes/>, 23 janvier 2024.
بيبليوغرافيا
المؤلفات العامة
س. جلول، نظام الإفلاس وخصائصه بعد تعديل قانون التجارة ٢٠١٩ (مع الاجتهاد الحديث)، منشورات الحلبي الحقوقيّة، بيروت-لبنان، ٢٠٢٣.ّ
[1]SWEID M., UNDP, « Escalade des hostilités au Liban : le Programme des Nations Unies pour le développement met en garde contre une crise socio-économique », < https://www.undp.org/lebanon/press-releases/escalade-des-hostilites-au-liban-le-programme-des-nations-unies-pour-le-developpement-met-en-garde-contre-une-crise-socio>, 24 octobre 2024, visité le 26-12-2024.
[2]THOMAS P-L., Le particulier Figaro, « L’économie libanaise s’enfonce un peu plus dans le chaos », < https://www.lefigaro.fr/conjoncture/l-economie-libanaise-s-enfonce-un-peu-plus-dans-le-chaos-20240928#:~:text=Dans%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9%2C%20les%20effets,une%20partie%20de%20la%20population>, 28 septembre 2024, visité le 26-12-2024.
[3] Ibid.
[4]Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, «Direction générale du trésor », < https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/LB/cadrage-general#:~:text=Entre%202019%20et%202023%2C%20les,par%20les%20d%C3%A9penses%20de%20fonctionnement>, 27 juin 2024, visité le 27-12-2024.
[5]MAUREL L., «Commerces en faillites : quels sont les secteurs les plus impactés ? », < https://lechommerces.fr/faillites-dentreprises-quels-sont-les-secteurs-du-commerce-les-plus-impactes/>, 23 janvier 2024, visité le 28-12-2024.
[6] س. جلول، نظام الإفلاس وخصائصه بعد تعديل قانون التجارة ٢٠١٩ (مع الاجتهاد الحديث)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت-لبنان، ٢٠٢٣، ص ٥.
[7] Aux termes de l’art. 268 COC, « Le créancier a un droit de gage général, non pas sur les biens de son débiteur, isolément envisagés, mais sur le patrimoine même de ce débiteur, considéré dans sa généralité.
Ce droit, qui fait du créancier l’ayant-cause à titre universel de son débiteur, ne lui confère, par lui-même, ni droit de suite, ni droit de préférence: tous les créanciers chirographaires sont, en principe, placés sur le même plan, sans distinction tirée de la date de la naissance de leurs droits, et réserve faite des causes légitimes de préférence procédant de la loi ou de la convention ».
[8] س. جلول، نظام الإفلاس وخصائصه بعد تعديل قانون التجارة ٢٠١٩ (مع الإجتهاد الحديث)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت-لبنان، ٢٠٢٣، ص٧.
[9] LECUYER H., « La faillite de l’entreprise en droits libanais et français », CEDROMA, 2004, p. 165.
[10] وفقًا للمادة ٤٨٩ من قانون التّجاريّ اللّبنانيّ: مع الاحتفاظ بتطبيق أحكام الباب السّابق يعدّ في حالة الإفلاس كلّ تاجر ينقطع عن دفع ديونه التّجاريّة، وكلّ تاجر لا يدعم الثقة الماليّة به الا بوسائل يظهر بجلاء أنّها غير مشروعة.
[11] وفقًا للمادة ٤٩٨ من قانون التّجاريّ اللّبنانيّ: إذا ظهر للمحكمة عرضا في أثناء محاكمة مدنية أو تجاريّة او جزائيّة أنّ التّاجر في حالة إفلاس ظاهرة فيحق لها، وإن يكن الإفلاس لم يعلن،أن تطبق أحكام الإفلاس الأساسية كما هي محدّدة في هذا الكتاب.
[12] وفقًا للمادة ٤٩١ من قانون التّجاريّ اللّبنانيّ: يجوز أن ترفع القضية إلى المحكمة بتصريح من التّاجر نفسه، ويجب عليه أن يقوم بهذا التّصريح في خلال عشرين يومًا من تاريخ انقطاعه عن الدّفع والا استهدف لارتكاب جنحة الإفلاس التّقصيريّ وعليه أن يودع في الوقت نفسه موازنة مفصلة ومصدق على كونها مطابقة لحالة موجوداته والدّيون المطلوبة منه.